Miguel Shema : Dans ‘Qui a tué mon père’ vous écriviez : « Il y a ceux à qui la jeunesse est donnée et ceux qui ne peuvent que s’acharner à la voler ». De la dépossession de la jeunesse il en est question dans ‘Combats et métamorphoses d’une femme‘, vous donnez à voir comment les structures familiales et la classe sociale de votre mère ont fait qu’elle n’a pas eu de jeunesse. Est-ce qu’elle a réussi à voler un peu de jeunesse ?
Edouard Louis : Oui, l’histoire de ma mère c’est l’histoire d’une vie volée et donc aussi l’histoire d’une jeunesse volée, comme l’a été la vie et la jeunesse de beaucoup de femmes et c’est pour ça qu’il me semblait important d’écrire ce livre, pour m’insurger contre ça.
C’est l’histoire d’une femme des classes populaires qui, de par sa place au monde, a subi une double domination : une domination de genre et une domination de classe. En fait, et c’est une idée qui traverse Combats et métamorphoses, c’est comme si la domination de classe redoublait la domination de genre, comme si les femmes des classes populaires étaient deux fois plus femme que les autres femmes – femme ici au sens d’une identité imposée, au sens d’un destin limité par l’ordre masculin.
Mon père attendait de ma mère qu’elle fasse la cuisine, le ménage, qu’elle reste toute la journée à la maison.
Parce qu’au fond la domination de classe – ne pas avoir d’argent, ne pas avoir de diplôme, ne pas avoir de relations – fait qu’il est encore plus difficile quand tu es une femme qui subit la domination masculine de t’enfuir. Je le raconte dans le livre, mon père attendait de ma mère qu’elle fasse la cuisine, le ménage, qu’elle reste toute la journée à la maison.
Il voulait être le maître du temps, celui qu’on devait attendre pour manger lorsqu’il allait au café avec ses copains. Il se moquait de ma mère, faisait des blagues sur son physique devant les autres.
On voit ici l’intérêt de penser la domination de classe et la domination de genre, comme deux dynamiques qui fonctionnent ensemble.
Ma mère était tombée enceinte à 17 ans, elle n’avait pas pu faire d’études, puis enceinte une deuxième fois à 20 ans, sans argent, elle était prise au piège. À cause de la domination de classe, elle ne pouvait pas fuir la domination de genre – elle le répétait d’ailleurs en parlant de son premier mari « J’aurais voulu partir, mais pour aller où ? ». On voit ici l’intérêt de penser ensemble la domination de classe et la domination de genre, pas seulement comme deux choses qui coexisteraient l’une à côté de l’autre, mais comme deux dynamiques qui fonctionnent ensemble.
Donc oui, de par cette vie là, ma mère a eu une jeunesse volée. Pourtant Combats et métamorphoses raconte le contraire de Qui a tué mon père. Si Qui a tué mon père racontait l’histoire d’un homme broyé par le système des classes, par la précarité, par la vie à l’usine, Combats retrace à l’inverse l’histoire d’une émancipation. La trajectoire d’une femme qui un soir, à 45 ans, après mon départ de la maison familiale m’appelle et me dit : « Ça y est. Je l’ai fait ». Ce : « Ça y est. Je l’ai fait » voulait dire « J’ai jeté ton père à la rue. Je me suis libérée de lui ».
À partir de ce moment-là ma mère a commencé à se reconstruire une liberté, elle a changé de nom, elle est partie vivre dans une grande ville pour la première fois de sa vie. Elle est partie à la recherche de cette jeunesse qu’elle n’avait pas eue, à la recherche de cette insouciance, de ce bonheur, de ces sourires qu’elle n’avait jamais eus. Mon livre tente de faire l’archéologie de cette libération.

La métamorphose de sa mère, c’est tout l’enjeu du nouveau livre d’Edouard Louis.
M.S. : À la suite de la scène de l’appel, vous écrivez : « elle était ma mère, mais soudainement elle était plus jeune que moi ». Comme si tout d’un coup elle avait rattrapé une certaine jeunesse qu’on lui avait volée…
E.L : Exactement. Une fois libérée de mon père, elle saisit cette possibilité d’expérimenter le bonheur. Elle voyage pour la première fois, elle se fait des amies. Une renaissance s’opère…
Quand on vous met de côté, vous êtes forcé de faire un pas de côté et donc vous voyez mieux la réalité telle qu’elle est – brutale, injuste, laide.
L’hypothèse du livre c’est que ma mère ayant été dominée à l’intérieur de sa vie et à l’intérieur de la structure familiale en tant que femme, mise de côté par rapport à l’ordre qui régissait la vie autour de nous, a pu paradoxalement être consciente qu’on lui avait volé quelque chose.
C’est ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de la domination, le fait que parfois, les exclus sont justement celles et ceux qui parviennent à s’émanciper parce qu’ils ont été exclus, et que cette exclusion leur a donné une lucidité sur le monde. Quand on vous met de côté, vous êtes forcé de faire un pas de côté et donc vous voyez mieux la réalité telle qu’elle est – brutale, injuste, laide.
Alors que très souvent pour les hommes des classes populaires, comme mon père ou mon frère, la violence de classe qu’ils subissaient apparaissait comme une élection, comme quelque chose de choisi. Arrêter l’école très jeune, avoir des formes de travail très dures, ouvriers, balayeurs, avoir un corps abîmé par l’alcool, tout ça apparaissait comme un choix, « Je suis un homme, je suis un dur ». Ma mère, elle, en tant que femme, n’avait pas ce privilège de vivre sa vie comme un choix et c’est cette absence de privilège qui a rendu possible une forme de libération.
M.S. : Ce que vous dites sur les hommes de votre village, votre père ou votre frère, me fait penser à une phrase de Bourdieu qui disait « les agents ont le goût de ce à quoi ils sont de toute façon condamnés ». Est-ce que vous diriez que les hommes de votre village avaient encore plus le goût de ce à quoi ils étaient condamnées que votre mère et vous par exemple ?
E.L. : Oui exactement, parce qu’en tant qu’hommes, dans un monde où régnait l’ordre masculin, ils étaient au cœur du pouvoir. C’est mon père qui décidait à la maison, c’est mon père qui faisait la loi, c’est lui qui décidait de comment on organisait la journée, de ce qu’on mangeait, de qui on voyait ou pas.
Les dominants sont bêtes par définition, puisqu’ils dominent et que rien dans leur vie ne les pousse à interroger la réalité.
C’était lui par exemple qui avait le permis de conduire, donc si ma mère disait qu’elle avait envie de voir la mer, puisqu’on était pas très loin, c’est lui qui pouvait décider si on y allait ou non. Il souffrait de la pauvreté et de la précarité, mais dans ce monde de précarité, il était le chef, et cela produisait chez lui une forme de cécité, une forme d’aveuglement, d’adhésion au monde tel qu’il est.
Les dominants sont bêtes par définition, puisqu’ils dominent et que rien dans leur vie ne les pousse à interroger la réalité. Alors que ma mère, en tant que femme, ou moi en tant, que gay, on avait une conscience beaucoup plus grande de l’injustice, et donc une propension plus grande à questionner l’évidence avec laquelle le monde autour de nous fonctionnait.
En ce sens, ce livre est presque un livre de convergence des luttes. C’est pas un hasard si Almodovar qui est un cinéaste gay a fait tellement de films sur des figures de femmes, si Xavier Dolan qui est gay a fait tellement de film sur des figures de femmes, si Patti Smith qui est une femme a écrit Just kids sur la grande amitié de sa vie avec Mapplethorpe qui était gay. Très souvent il y a une forme de communauté de destin, puisque les femmes et les gays vivent la même domination, celle de l’ordre masculin.
Si la domination peut donner une lucidité sur le monde, elle peut aussi écraser, et c’est ce qui se passe le plus souvent.
M.S. : Qu’est-ce qui a été le plus compliqué dans l’écriture ?
E.L. : Pour moi c’est toujours un enjeu très difficile quand on écrit un livre sur une personne qui se libère. Parce que justement, la plupart des gens qui subissent la violence sociale sont détruits par elle, ils ou elles ne s’en sortent pas. Je ne voulais pas que le fait d’écrire un livre sur l’émancipation d’une femme invisibilise le fait que beaucoup de femmes n’ont pas pu ou ne peuvent pas s’émanciper. Si la domination peut donner une lucidité sur le monde, elle peut aussi écraser, et c’est ce qui se passe le plus souvent. L’émancipation n’est pas une conséquence logique de la violence.
C’est un exercice difficile parce que tout le monde aime les histoires de métamorphose. Si vous allez dans une salle et que vous dites « vous pouvez devenir ce que vous voulez », tout le monde vous applaudira. En revanche, si vous dites qu’il y a des vies qui ne seront jamais sauvées, qui sont brisées, vous avez plus de chance de recevoir un accueil froid. Je ne voulais pas que mon livre puisse être aimé pour de mauvaises raisons.
Comment écrire l’histoire d’une métamorphose qui rendrait encore plus visibles les métamorphoses qui n’ont pas pu avoir lieu ?
J’ai donc construit le livre avec cette question en tête : comment écrire l’histoire d’une métamorphose qui rendrait encore plus visibles les métamorphoses qui n’ont pas pu avoir lieu ? Comment écrire une histoire au fond, belle – celle d’une émancipation, l’émancipation de ma mère – qui rendrait encore plus en colère à l’idée que cette émancipation n’est pas toujours possible. Est-ce qu’il est possible de créer de la colère à partir de la beauté ? C’est un peu la question qui est en soubassement de chaque ligne et de chaque page de ce livre.

Edouard Louis et sa mère en selfie.
M.S. : Vous parlez aussi des métamorphoses avortées dans le livre, par exemple de l’amitié de votre mère avec Angélique. Est-ce que vous pouvez raconter comment Angélique, cette femme qui après une peine de cœur s’est réfugiée chez vous, a rendu de nouvelles envies, de nouvelles aspirations, possibles pour votre mère ? Et aussi raconter comment tout cela a pris fin ?
E.L. : Je suis content que vous en parliez parce que pour moi c’est l’une des histoires les plus importantes de ce livre. La scène commence à une sorte de kermesse du village comme il y en avait régulièrement, avec des manèges dans les rues, des auto-tamponneuses. Un jour mes parents ont vu cette femme, Angélique, qui pleurait dans son coin pendant une de ces kermesses.
C’était une femme qu’on connaissait mais à qui on n’avait jamais parlé parce qu’elle avait un autre statut social dans le village. Comme très souvent dans les petits villages il y avait une sorte de petite élite, qui nous intimidait beaucoup socialement, le médecin, le maire, la patronne de l’épicerie. Cette femme était chargée du réseau d’électricité dans la région, c’était quelqu’un qui avait fait un peu d’études, qui fréquentait plutôt le monde qui nous intimidait.
Je me souviens, quand on voyait le médecin du village, quand il venait à la maison, par sa simple présence on se sentait presque humilié de ne pas savoir parler aussi bien que lui, de ne pas se tenir aussi bien que lui, son corps était un rappel de notre infériorité. Il suffisait qu’un corps apparaisse pour qu’on se sente infériorisé, et Angélique faisait partie de ce groupe.
Ma mère a trouvé chez Angélique une alliée pour résister à l’oppression que lui faisait vivre mon père.
Ce jour-là, elle pleurait parce qu’elle était brisée par une rupture amoureuse. Elle était vraiment très malheureuse. Étonnement cette condition psychologique, le chagrin d’amour, a rendu possible le contact avec elle, et donc avec un milieu duquel on était coupé d’habitude. Un facteur psychologique a remis en cause les frontières sociologiques habituelles. Mes parents sont allés lui demander pourquoi elle pleurait, et ils se sont rapprochés de cette femme, notamment ma mère, et ma mère s’est libérée au contact de cette femme.
Elle a trouvé chez Angélique une alliée pour résister à l’oppression que lui faisait vivre mon père. Ma mère a commencé à imiter Angelique, elle a commencé à aller chez le coiffeur alors qu’elle n’allait jamais chez le coiffeur avant, à prendre soin d’elle, à s’affirmer, à se moquer de mon père avec son amie. Elle a vécu tout à coup une autre vie.
Mais un jour cette femme a cessé d’être triste, elle est retombée amoureuse, et comme elle est sortie de cette détresse psychologique, la relation avec mes parents est devenue impossible. Elle a arrêté de venir les voir, elle a abandonné ma mère. Elle a disparu du jour au lendemain sans qu’on ne comprenne pourquoi alors que pendant 3 ans elle était tout le temps chez nous. Ma mère a été bouleversée.
Un jour je suis allé voir Angelique pour lui demander pourquoi elle avait arrêté de venir nous voir. Elle m’a dit « Je ne supportais plus la télé tout le temps, je ne supportais plus ton père qui parlait mal, je ne supportais plus un certain nombre de valeurs, je ne supportais plus le racisme de ton père ». C’est comme si la condition psychologique malheureuse de cette femme avait effacé pendant quelques années les frontières de classes… Dans une certaine mesure bien sûr. Mais à partir du moment où cette détresse psychologique a disparu, cette frontière sociale est réapparue immédiatement.
M.S. : En voyant sa métamorphose à elle, ou même la vôtre, est-ce que vous avez une idée des conditions qui rendent une transformations possible, ou bien ces dernières ne sont que des miracles qu’il n’est pas possible de comprendre ? Vous dites souvent que votre transformation n’est que le résultat de votre échec à correspondre aux attentes masculines de votre village.
E.L. : Dans le livre j’essaie de poser à plusieurs moments des éléments d’explication de cette métamorphose. Je pense que la métamorphose de ma mère est liée à la mienne, une histoire de convergence encore une fois… Comme beaucoup d’enfants gays, j’ai dû fuir ma famille pour ne pas suffoquer et donc j’ai été le premier à faire des études, j’ai été le premier à accéder à des milieux plus privilégiés.
En allant faire des études, tout à coup je rencontrais des femmes qui avaient plus de liberté, et qu’en comparaison la vie de ma mère me semblait de plus en plus intolérable.
À partir de ce moment-là j’ai commencé à voir d’autres vies que celles que j’avais toujours connues, d’autres formes d’existence. Si vous voulez cette espèce de distance que j’ai entretenue avec le monde de mon enfance, avec ma famille, a fait que j’ai d’autant plus été capable de voir la violence que ma mère subissait, parce qu’en partant à la ville, en allant faire des études, tout à coup je rencontrais des femmes qui avaient plus de liberté, et qu’en comparaison la vie de ma mère me semblait de plus en plus intolérable.
Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de domination masculine dans les classes dominantes, pas du tout, mais que dans ces classes plus aisées il existe souvent des manières de fuir, par le travail, par l’argent, par le simple fait de savoir aller parler à un avocat, ce que ma mère n’avait pas. C’est l’éloignement avec la violence qui m’a permis de voir la violence.
Si ma mère vivait dans un monde où il y avait plus d’assistance sociale, plus d’aides sociales, elle aurait pu partir plus tôt, s’émanciper plus vite.
Ça me rappelle ce que vous disiez dans votre texte sur l’expérience, sur le fait qu’il n’y a pas d’évidence immédiate de l’expérience. C’est au contraire quand je suis sorti des expériences directes, de la mienne ou celle de ma mère, que j’ai pu voir un certain nombre de choses, et la distance a été la condition pour comprendre les mécanismes sociaux.
À partir de là s’est enclenché un dialogue avec ma mère. Je lui disais qu’elle ne pouvait pas rester avec mon père, qu’elle ne méritait pas ça. Je ne lui apprenais rien, elle le savait, mais ce dialogue a renforcé son désir de fuite, comme si ma fuite avait renforcé l’idée selon laquelle elle devait fuir, comme si chaque fuite rendait d’autres fuites possibles.
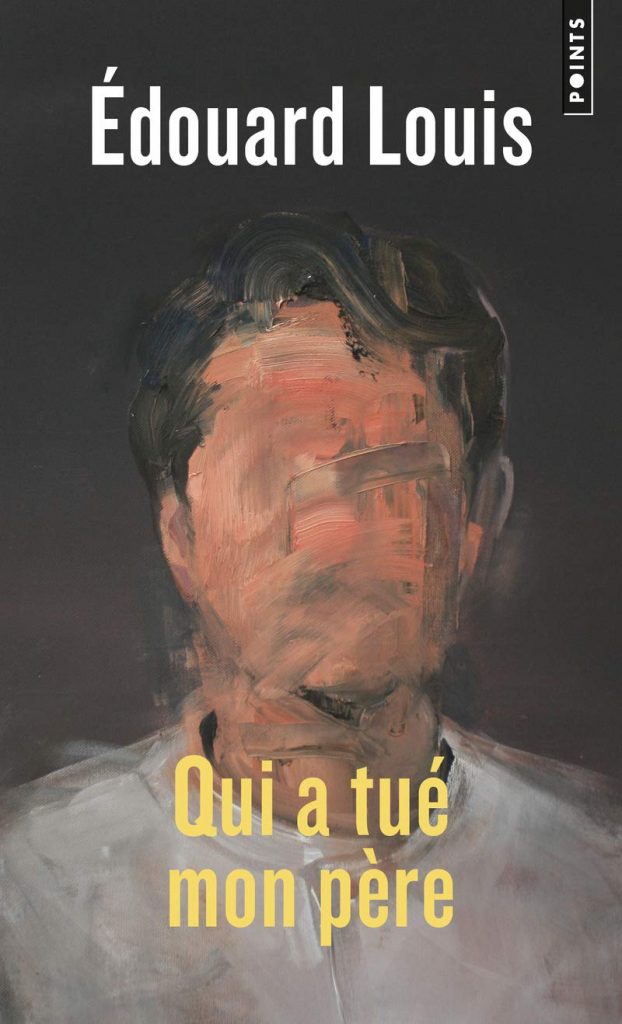
« Qui a tué mon père » est le deuxième roman auto-biographique d’Edouard Louis paru en 2018.
M.S. : C’est donc comme Qui a tué mon père, un livre politique..
E.L : Oui. On pourrait dire que ce qu’on voit aussi dans le livre, et ce dont on parle depuis tout à l’heure, c’est que si ma mère vivait dans un monde où il y avait plus d’assistance sociale, plus d’aides sociales, elle aurait pu partir plus tôt, s’émanciper plus vite de mon père et de l’ordre masculin. Ça faisait des années qu’elle voulait partir. Mais elle se demandait comment faire. Où est-ce qu’elle aurait pu vivre, sans argent ?
La condition sociale est très importante quand on parle de la condition des femmes, et en ce sens on peut dire que toutes les réformes anti-sociales, toutes celles qui enlèvent de l’argent aux plus précaires, qui baissent les aides sociales, etc sont intrinsèquement et indirectement aussi des politiques de domination masculine, dans la mesure où ces reformes rendent encore plus difficile pour une femme des classes populaires de fuir si elle est face à un mari violent. Un gouvernement comme celui de Macron qui baisse le chômage, qui baisse les APL, qui baisse un certain nombre de prestations d’assistance, en fait il faut dire que c’est aussi un gouvernement qui renforce la domination masculine.
Il fallait que je raconte aussi comment en tant que fils j’avais reproduit des modèles d’oppression sur elle.
M.S. : Avant cette reconnaissance de la domination qu’elle subissait, votre transformation au début c’était aussi ne pas cesser de signifier l’écart qui se creusait entre vous à mesure que vous acquiérez du capital culturel. Comme par exemple quand vous lui disiez qu’il fallait qu’elle fasse écouter de la mesure classique à tes frères et sœurs….
E.L. : Si je faisais l’histoire de la trajectoire de ma mère et des formes d’oppression qu’elle a vécues je ne pouvais pas me mettre en dehors de ça, ça aurait été un livre malhonnête. Il fallait que je raconte aussi comment en tant que fils j’avais reproduit des modèles d’oppression sur elle. Un moment je dis dans le livre qu’un fils face à sa mère reste un homme face à une femme.
Comme quasiment tous les enfants, je reproduisais la violence du monde.
En tant que petit garçon, je reproduisais aussi sur ma mère les discours que mon père tenait à son égard. Comme quasiment tous les enfants, je reproduisais la violence du monde. Il suffit de voir comment les enfants se traitent à l’école quand un petit garçon arrive avec un cartable rose. Il y a un conservatisme violent chez les enfants, presque un fascisme de l’enfance.
Et dans ma trajectoire de transfuge il y a eu tout un moment, où, comme j’avais souffert dans mon enfance en tant que gay, j’ai en un certain sens voulu me venger du milieu de mon enfance. Je voulais sans cesse signifier à ma mère que j’était en train de devenir ce que je croyais « mieux » qu’elle. Quand je revenais du lycée le week-end, je disais des phrases à ma mère qui étaient d’une extrême violence : « Tu devrais écouter Mozart et Beethoven ça ouvre l’esprit » ou bien « Tu devrais faire écouter de la musique classique aux enfants ».
Pour moi aujourd’hui écrire c’est écrire contre cette violence.
Je voulais toujours signifier que je devenais autre chose. Pour moi aujourd’hui écrire c’est écrire contre cette violence qu’on peut incarner quand on est un transfuge de classe, essayer de défaire la violence par l’écriture. D’analyser la violence et donc de la défaire. L’écriture comme une odyssée qui consisterait à défaire la violence.
M.S. : Je voudrais revenir sur une scène qui m’a beaucoup touché, celle de votre presque mort. Un jour vous vous retrouvez à sentir une douleur abdominale très importante, vous décidez donc de rentrer chez vous – la douleur ne diminue pas – vous demandez à votre mère d’appeler le Samu, elle ne le fait pas. Vous irez finalement voir le médecin, pour découvrir que c’était une appendicite, qui se serait transformée en une péritonite – bien plus grave qu’une simple appendicite. Dans ce refus d’appeler le Samu qu’est-ce qui est en jeu ?
E.L. : Ça a été une péritonite d’ailleurs, je suis resté trois semaines à l’hôpital. Le rapport à la médecine dans les classes populaires de mon enfance apparaissait comme quelque chose de bourgeois, comme une marque de distinction de la bourgeoisie qui veut toujours voir des médecins pour prendre soin d’elle parce qu’elle se sent importante. Il y avait dans mon enfance l’idée d’une force des classes populaires, l’idée d’un vitalisme, l’idée d’un virilisme qui faisait qu’on disait : « On n’est pas des chochottes comme les bourgeois » et donc on n’allait pas voir le médecin quand quelque chose n’allait pas. Cette question de la médecine était une obsession.
Cette violence de classe entre ma mère et moi est quelque chose qui a failli me tuer.
Et cette scène de la péritonite se passe précisément à l’époque où je disais à ma mère qu’elle aurait dû écouter Mozart ou Beethoven, ce qui était une manière de dire « Je ne suis plus comme toi ». Ce jour où j’ai eu cette douleur abdominale terrible, dire à ma mère : « J’ai mal je veux voir un médecin », c’était la même chose que de dire « Tu devrais écouter Beethoven ». Elle voyait cela comme une manière pour moi de dire que j’étais d’un autre milieu, que j’étais un bourgeois. Cette violence de classe entre elle et moi est quelque chose qui a failli me tuer, parce que ma mère ne voulait pas appeler le médecin, et une fois que j’ai vu le médecin il m’a dit que j’étais à quelques heures de ne peut-être pas survivre.

« En finir avec Eddy Bellegueule » est le premier livre d’Édouard Louis, et celui qui l’a fait connaître au grand public.
M.S. : Est-ce qu’on ne peut pas lire cette scène aussi comme la remise en cause, par votre mère, de la douleur d’un homosexuel ? Dans En finir avec Eddy Bellegueule vous parliez des hommes de votre village qui résistaient à la médecine, vous racontiez la fois où vous aviez marché sur un clou et pendant plusieurs jours vous aviez refusé d’en parler, en désinfectant votre plaie avec le parfum de votre mère. Est-ce qu’elle n’a pas vu un homosexuel qui exagérait sa douleur, qui faisait des chichis, qui croyait mourir pour quelque chose qui « n’était rien » ?
E.L : Absolument. Il y avait une dimension de classe dans le rapport à la médecine qui était aussi une dimension sexuelle. On ne peut pas comprendre les habitus de classe sans analyser les rapports à la sexualité.
Je pense qu’aujourd’hui, renouveler l’analyse des classes passe par l’investigation des formes sexuelles de l’identité.
Toute la manière de construire son corps de classe dans les classes populaires de mon enfance était liée à une contre-identification sexuelle : ne pas manger des petites quantités de nourriture comme la bourgeoisie, mais au contraire des grosses quantités car c’est plus masculin, ne pas croiser les jambes comme les hommes de la bourgeoisie qui paraissaient efféminés, ne pas être aimé des enseignants à l’école contrairement aux filles et aux personnes sexuellement déviantes (les fayots, les chouchous, ceux qui se « soumettent » à l’ordre scolaire), ne pas trop prendre soin de son corps… Je pense qu’aujourd’hui, renouveler l’analyse des classes passe par l’investigation des formes sexuelles de l’identité.
M.S. : À qui ce livre s’adresse-t-il ? À certains passages vous vous adressez aux lecteurs, dans d’autres à votre mère. Pourquoi avoir choisi ce procédé, qu’est-ce qu’il signifiait pour vous ?
E.L. : J’ai voulu que ce soit un livre qui soit le plus proche d’une conversation entre moi et cette femme qui est ma mère. Dans une conversation, il y a toujours une partition consciente entre ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas, à chaque fois qu’on est confronté à quelqu’un il y a ce qu’on peut dire et ce qu’on a peur de dire.
Je cherchais une forme littéraire qui rendrait ça visible. Qu’est ce qu’on dit aux gens qui nous entourent ? Qu’est ce qu’on tait ? Où est la frontière entre les deux ? Et aussi, ce qui m’intéresse dans chaque livre, c’est d’essayer de trouver la forme littéraire qui me permettra le plus possible de dire ce que j’ai envie de dire, de mener le combat que j’ai envie de mener.
Si on ne trouve pas la forme littéraire qui convient à chaque vie qu’on veut raconter, alors on se condamne à ne pas complètement raconter ces vies.
Pour Qui a tué mon père je parlais d’un système politique qui avait écrasé un ouvrier, mon père. Le livre ressemblait parfois à un essai, parfois à un pamphlet, parfois à un manifeste. Dans Combats et métamorphoses, dans la mesure où je voulais parler d’une métamorphose, d’une belle histoire au fond, pour moi le livre devait ressembler plus à un poème, à une chanson, avec des refrains qui reviennent, des mêmes phrases que je reprends plusieurs fois. Si on ne trouve pas la forme littéraire qui convient à chaque vie qu’on veut raconter, alors on se condamne à ne pas complètement raconter ces vies.
M.S. : Vous écrivez à un moment « Je sais désormais qu’écrire sur elle, et écrire sur sa vie, c’est écrire contre la littérature. ». Quelle est la forme dominante de la littérature aujourd’hui ?
E.L. : On sait que la littérature est majoritairement écrite par des gens qui viennent des classes privilégiées, souvent de la petite bourgeoisie culturelle. Donc évidemment les histoires comme celles de ma mère sont très peu racontées. Écrire contre la littérature, ça commence par là : raconter des vies que le plus souvent la littérature passe sous silence.
L’autobiographie m’intéresse parce qu’elle a une force de confrontation politique qui est très grande.
L’autre dimension, c’est de le faire à travers l’autobiographie, qui reste encore aujourd’hui une forme minoritaire dans l’espace littéraire, suspectée de narcissisme, d’être moins littéraire, etc. Combien de fois on m’a demandé « Et maintenant que vous avez fait de l’autobiographie, c’est pour quand la fiction ? », comme si l’autobiographie ne pouvait pas constituer une œuvre en soi, comme si elle ne pouvait être qu’une étape.
Comme je l’ai souvent dit l’autobiographie m’intéresse parce qu’elle a une force de confrontation politique qui est très grande, parce que quand vous faîtes de l’autobiographie il y a quelque chose qui est de l’ordre du « C’est là, ce que je décris, cette violence, c’est en train d’arriver. Qu’est-ce que vous faites contre ça, contre monde ? ».
L’autobiographie dérange les gens, l’autobiographie met les gens mal à l’aise. C’est étonnant les résistances que l’autobiographie suscite, on entend beaucoup de gens dire : « Y’a plus que ça, tout le monde veut dire « je ». Tout le monde veut écrire sur sa vie ». Mais cette forme dérange tellement, elle est selon moi tellement avant-gardiste, elle met tellement mal à l’aise qu’on a l’impression qu’elle est partout ; un peu comme Frédéric Vidal avec les études sur le colonialisme.
Il suffit qu’il y ait cinq personnes qui travaillent sur le colonialisme pour que le gouvernement macroniste pense que c’est partout, que tout le monde ne fait que ça, que ça envahit la France. Quand un discours dérange on a l’impression qu’il est partout, les réactionnaires se sentent dépassés. C’est la même chose en littérature et en politique.
Voir cette publication sur Instagram
Très actif pour le comité Adama, Edouard Louis est un des soutiens d’Assa Traoré, dans son combat pour la justice après la mort de son frère Adama, suite à l’interpellation des gendarmes le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise.
M.S. : Est-ce que vous pouvez revenir sur ce l’importance de l’explicite en littérature ? Et dire de quoi l’implicite que prône la littérature dominante est le nom ?
E.L. : Tout le champ littéraire est structuré en très grande partie par l’idée d’implicite, l’idée que faire de la littérature consisterait à ne jamais dire les choses directement, à ne jamais exprimer directement des idées parce que ça serait trop politique, trop didactique, et donc pas assez littéraire.
L’idée selon laquelle la littérature devrait à chaque fois essayer d’illustrer seulement les idées, de les euphémiser par des personnages, par des situations, plutôt que d’être explicite. Ça remonte à très loin, on voyait ça chez André Gide qui se demandait dans son Journal des Faux-Monnayeurs : « J’ai une idée à dire mais comment je peux le dire sans le dire ? ».
La littérature est une arme des classes dominantes – car qui lit ? – et il y a un intérêt inconscient au fait de garder la réalité implicite et pas explicite.
C’est une vieille idée qui traverse le champ littéraire depuis très longtemps. Et tout cela relève du fait que la littérature est une arme des classes dominantes – car qui lit ? – et il y a un intérêt inconscient au fait de garder la réalité implicite et pas explicite, parce que ça permet de ne pas se confronter à la laideur du monde, ça permet de ne pas trop s’interroger sur la réalité.
Je pense qu’on peut profondément créer du beau, créer du poétique, à travers une littérature de l’explicite. Je pense que la vérité peut être plus belle que la métaphore. Et c’est un des grands axes pour casser la littérature, pour casser la façon dont elle continue à être un instrument des dominants. Quand j’ai quelque chose à dire je ne l’illustre pas, je le dis.
M.S. : Est-ce que je me trompe si je dis que l’on peut lire votre œuvre comme une volonté de montrer comment les structures de classes, de genre et de sexualité, et les structures familiales dans ce dernier roman, empêchent, rendent impossible, l’insouciance d’une certaine jeunesse qu’on trouve chez les dominants ?
E.L. : Oui on peut dire les choses comme ça, la condition d’enfant gay qui a été la mienne fait que j’ai eu une enfance en partie volée. Je vivais à côté de mon enfance. Je pense que c’est quelque chose qui est difficile à réaliser pour des personnes qui n’ont pas vécu ça, qu’est-ce que c’est de vivre une enfance avec un secret aussi lourd que celui d’un désir caché ?
J’ai vécu à côté de mon enfance, exactement comme mon père a vécu à côté sa jeunesse parce qu’il a travaillé à l’usine très jeune, et exactement comme ma mère qui a eu des enfants très tôt.
Tous les jours, au quotidien. Tu joues avec les autres enfants et tu te dis qu’il ne faut pas que tu fasses un cri trop aigu, tu te dis qu’il ne faut pas avoir l’air trop gay, tu te dis qu’il ne faut regarder les garçons avec trop d’insistance. Les autres jouent, toi tu réfléchis, tu esquives à chaque instant.
J’ai vécu à côté de mon enfance, exactement comme mon père a vécu à côté sa jeunesse parce qu’il a travaillé à l’usine très jeune, et exactement comme ma mère qui a eu des enfants très tôt et en tant que femme n’a pas eu la liberté de faire ce qu’elle voulait. Donc oui, d’une certaine manière, mes livres sont des manifestes pour la possibilité de la jeunesse.
Propos recueillis par Miguel Shema



